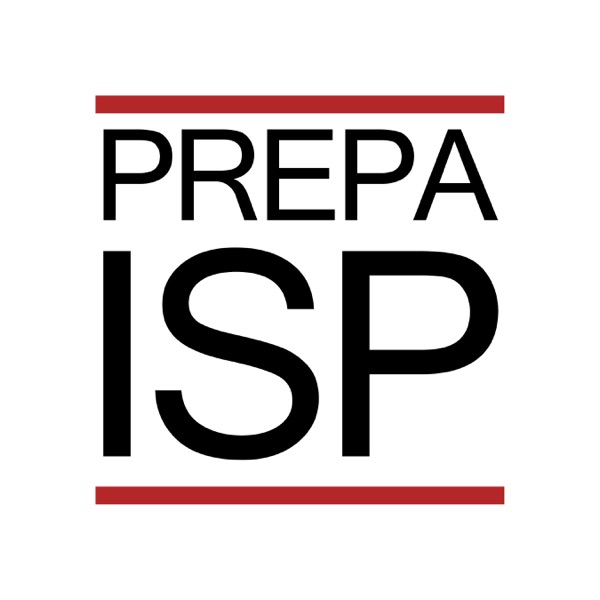La religion dans la société contemporaine
Les podcasts de l'ISP - Un podcast de Prépa ISP - Les mercredis

Catégories:
Le sujet que vous allons envisager dans ce podcast est comme souvent un sujet qui a été donné à l’occasion de grands oraux des concours auxquels nous préparons au sein de la Prépa ISP. De mon point de vue, il s’agit de l’un des plus difficiles, mais trêve de bavardage et commençons. La réouverture de Notre Dame de Paris, le débat sur le voile des accompagnantes scolaires ou plus généralement dans l’espace public, les crèches de Noël au sein des mairies ou sur leur parvis, l’agression d’un rabbin à Orléans. La religion est présente en permanence dans le débat public et notre société moderne, sécularisée, laïque n’a visiblement pas fait disparaître la religion de ses actualités. Mais qu’entend-on par « la religion », dans une telle société pourtant supposée n’avoir aucun parti pris spirituel imposé ? Comme nous l’expliquera notre invité du jour – je le cite par anticipation - notre regard sur la définition de LA Religion ne peut être celui d’un athénien, de l’époque de Socrate, ni celle d’un Français de l’an 1500 ni celle d’un Taliban de l’Afghanistan d’aujourd’hui. Concrètement, dans une perspective de « culture générale » républicaine, la religion peut être définie comme un système de croyances et de pratiques organisées autour du sacré. Traditionnellement, la religion unit une communauté autour de rites, de symboles, d’un dogme et souvent d’une institution. Cette définition, la plus communément admise, nous la devons au grand sociologue Emile Durkheim. A propos de son inscription dans la société contemporaine puisque c’est notre sujet, rappelons que pour Marcel Gauchet, la religion fut bien la matrice des sociétés humaines, mais selon le même auteur, les sociétés modernes s’en sont progressivement extraites. Nous serions passés d’un monde où la religion structure le social, à un monde où elle devient un fait privé, individuel, fragmenté. Est-ce une réalité ? De plus, « LA » religion aujourd’hui renvoient plutôt à la diversité DES religionS, et à leur coexistence dans l’espace public, à leur hiérarchie symbolique ou politique dans nos sociétés. Le sujet est d’autant plus évolutif que les sociétés démocratiques occidentales modernes sont confrontées à la globalisation, à la pluralisation des références culturelles (individuelles ou communautaires). Comment comprendre dès lors la place de la religion dans un tel contexte ? La France et sa laïcité républicaine constituent-elles des exceptions ? Pour répondre à ces questions, je reçois à Philippe Mazet, professeur de culture générale au sein de la Prépa ISP.